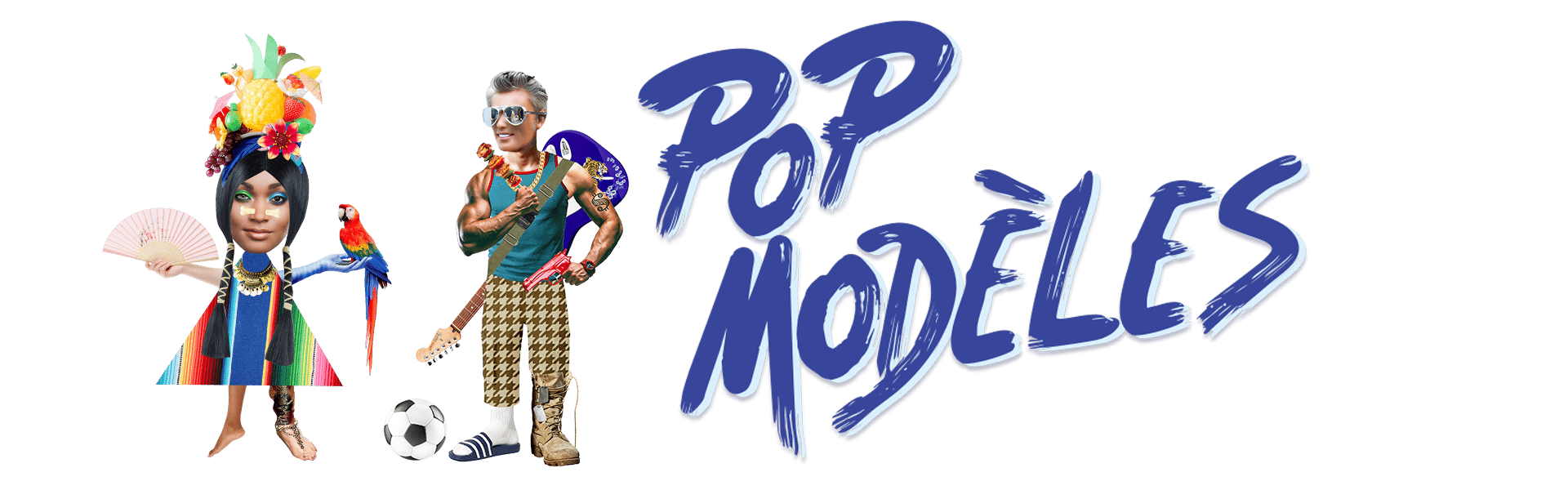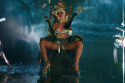“Alors que les hommes agissent, les femmes apparaissent. Les hommes regardent les femmes. Les femmes se regardent être observées. Cela ne détermine pas seulement les relations entre les hommes et les femmes mais aussi la relation des femmes envers elles-mêmes. Celui qui valide la femme est l’homme. Elle se transforme en objet – et plus exactement en un objet que l’on regarde : une vision.”[1]
John Berger, Ways of seeing, 1972
Quelles sont les représentations du genre féminin dans la culture médiatique populaire ? Si le sujet est vaste et a déjà fait couler beaucoup d’encre, les préoccupations qu’il suscite vont crescendo et contribuent à alimenter un débat de société fondamental. Les images et les fonctions des personnages féminins dans les fictions et l’espace médiatique témoignent des évolutions, des résistances et de la perpétuation des inégalités entre les genres. Elles permettent également d’observer l’interaction entre les médias et les enjeux sociaux et offrent de nombreuses perspectives critiques qui traduisent chacune une dimension des inégalités et des rapports de domination. Evidemment infiniment multiples, les femmes sont souvent réduites à quelques modèles aux fonctions subalternes qu’il convient de décrypter pour identifier les dimensions de la culture sociale qui nécessitent de changer.
Chercher la femme
Prenons le cinéma par exemple. Alors que les rôles masculins se veulent complexes et variés, les actrices féminines sont souvent cantonnées à des clichés : la mère de famille bonne pâte s’oppose à la sorcière acariâtre, la sainte nitouche fait les gros yeux à la prostituée vénale. Leur existence même se justifie régulièrement par les relations qu’elles entretiennent avec des hommes[2] : comme au temps de l’amour courtois, elles font l’objet d’une quête, elles sont des sources d’inspiration ou l’élément déclencheur d’une série d’événements. Il est rare qu’elles soient meneuses de troupes et maîtresses de leur propre destinée, encore plus qu’elles soient les méchantes et les génies du mal. Les fictions sont frileuses lorsqu’il s’agit d’imaginer des femmes quitter les fonctions que leur genre leur réserve. On les valorisera plutôt pour leur apparence physique, conventionnellement plaisante, et quand elles font usage de leur force, ce n’est pas sans susciter un certain émoi sexuel, à l’instar de Wonder Woman dont l’adaptation de 2017, pourtant réputée féministe, souligne ses aptitudes combattantes par un gros plan de son postérieur lui servant à arrêter les balles.

D’ailleurs, les armures des hommes et des femmes ne semblent pas répondre aux mêmes critères de fabrication. Si celles des hommes servent à les protéger, celles des guerrières se résument souvent à des bikinis blindés comme l’illustrent souvent les jeux vidéo, où les avatars féminins – souvent délaissés par les joueurs – sont volontiers caractérisés par leur propension à séduire. Mais qui doit-on blâmer ? Difficile de démêler les fils d’une culture à laquelle nous participons tous… et toutes. Pourtant, un constat traverse les industries du cinéma, des jeux vidéo ou de la musique : les postes créatifs et décisionnels sont majoritairement détenus par des hommes. Coïncidence ?
Qu’est-ce que la culture populaire ?
Ce concept fourre-tout et parfois péjoratif traduit d’abord une large audience. Culture de masse, elle s’est historiquement construite par contraste avec une culture jugée élitiste et plus intellectuelle. Alors que la high culture requerrait un certain bagage de connaissances pour être parfaitement comprise, bagage qui permet de se distinguer de la « masse », la low culture servirait avant tout à se divertir, pas à « se prendre la tête ». Assis confortablement sur ses toilettes, on lira plutôt une bande dessiné et on réservera L’enfer de Dante à un moment plus opportun. Un exemple que Walter Benjamin aurait pu utiliser pour illustrer son essai L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique[3] où il distingue le divertissement de l’art, en ce sens où le premier est abordable par les foules, tandis que le second, menacé par l’industrialisation, requiert de la concentration. Parce qu’elle est à la portée du plus commun des mortels, ses détracteurs mépriseront la culture populaire considérée comme violente, vulgaire, bête,…
Depuis quelques années cependant, les frontières se brouillent et les événements célébrant la culture populaire dans des lieux où elle n’avait jusqu’alors pas droit de cité se multiplient : pensons à la très récente exposition Yo visible au centre d’art contemporain bruxellois Bozar[4], au festival Are You Series ?[5], organisant projections et conférences autour des séries télévisées – également au Bozar – mais aussi à la « pop philosophie », exercice au cours duquel des penseurs cherchent à illustrer des concepts philosophiques en mobilisant des références médiatiques grand public. Car en tant que support d’apprentissage, la culture populaire permet d’illustrer une réflexion en faisant appel à une référence partagée par tous[6], rendant de ce fait la conversation plus accessible.
Si cette culture partagée par le plus grand nombre a longtemps provoqué méfiance et mépris, à la fois au sein des mouvements intellectuels de gauche, soucieux de l’abrutissement des masses, et des élites bourgeoises, gardiennes de la culture au grand « C », elle est aujourd’hui mieux considérée, notamment dans les milieux académiques qui n’hésitent plus à célébrer et réfléchir aux œuvres, reconnues comme telles, des Tolkien, Hergé ou Spielberg[7].
Qu’est-ce que le genre ?
Dans le champ des sciences sociales, le genre caractérise des individus par des traits qui sont attribués au « féminin » ou au « masculin » dans une société donnée et à un moment donné. Le genre est donc une construction culturelle qui varie dans l’espace et le temps et se distingue du sexe biologique qui, lui, est réputé inné[8] et auquel il se « colle ». Être une femme en Belgique aujourd’hui ne signifie probablement pas la même chose que l’être en Inde, il y a 1000 ans : si les structures sociales évoluent, il en va de même pour les traits et fonctions attribués aux individus en fonction de leur sexe. Dans les premières années de l’informatique, les femmes étaient largement employées dans un secteur qui jugeait peu valorisant d’encoder des lignes de caractères répétitifs pour alimenter des machines. A l’occasion du boom des technologies numériques, l’informaticien est pourtant devenu un archétype masculin qui s’accompagne parfois de justifications scabreuses pour expliquer la faible absence des femmes dans ce métier[9].
Or, la pérennité d’une société repose en partie sur sa capacité à transmettre des récits, des mythes qui perpétuent son fonctionnement et justifient son existence. Observer et analyser les représentations des genres spécifiques à une société dans les récits qu’elle partage et apprécie permet donc de saisir les rapports sociaux entre ces genres, d’en identifier les valeurs et la manière dont celle-ci sont distribuées.
La subordination du personnage féminin
Dans les années 1970, Laura Mulvey, psychanalyste et critique de films britannique, proposait un concept relatif aux représentations de genres dépeintes à l’écran : le male gaze, le « regard masculin ». Dans la majorité de nos productions médiatiques, les femmes ne s’animent que parce qu’elles sont observées par des hommes. Elles sont passives, dans l’attente, tandis que les hommes sont actifs et donnent un sens à la narration. C’est comme si une fois l’homme sorti de la pièce, la femme avec qui il discutait une minute auparavant se désactivait : le cours de sa vie n’a aucune importance.

Il est aisé de tracer un parallèle avec nos quotidiens : les femmes sont encore majoritairement associées aux travaux domestiques, à l’univers de la maison[10] tandis qu’il revient aux hommes de mener des carrières professionnelles, de « partir à la chasse » pour offrir à sa famille son pain quotidien. L’homme a une place dans l’espace public, il a un nom, tandis que la femme est une femme au foyer anonyme, au mieux une « épouse de… » Caricatural ? En 2015, l’agence de presse Associated Press annonçait sur Twitter qu’Amal Clooney prenait la défense d’un journaliste d’Al-Jazeera, préférant faire usage de ses 140 caractères pour rappeler qu’il s’agissait de la femme de l’acteur George Clooney plutôt que d’indiquer qu’elle est surtout une avocate spécialisée en droits de l’homme. Les attaques sexistes qui ont pris pour cible Hillary Clinton durant la dernière campagne électorale états-unienne illustre également la difficulté pour les femmes politiciennes d’être respectées au même titre que leurs homologues masculins, dont on louera le charisme, alors qu’une même attitude vaudra à une femme d’être taxée d’« autoritaire ».
L’observation de la routine médiatique populaire met en lumière les récurrences et souligne aussi les absences : on remarque que la majorité des femmes qui apparaissent à l’écran ont entre 34 et 41 ans. Au-delà, leur présence chute progressivement pour ne finalement représenter que 3% des personnages de plus de 65 ans. Du côté des hommes, le phénomène est inverse : plus ils vieillissent, plus ils sont visibles. Un indicateur qui pourrait suggérer que dans notre société contemporaine, la présence d’une femme se justifie par le désir qu’elle peut susciter, par sa beauté ou pour sa capacité à procréer. Le genre féminin se trouve ainsi continuellement stigmatisé dans les médias : il est à la fois signalé par certains traits qui constituent le genre – le corps, le rôle social ; être « jolie » ou être mère – et, une fois signalé, consigné à des fonctions sociales qui sont périphériques au genre masculin à qui il revient de mener les récits et de faire évoluer la société. Les récits médiatiques participent alors à différentier les genres : le destin d’une femme n’est pas celui d’un homme. Au-delà même du constat que ces destins sont inégaux, le fait même que des êtres humains soient enfermés dans des modèles sociaux qui leur sont assignés pose problème. D’ailleurs, s’interroger sur la stigmatisation des femmes dans notre culture populaire médiatique n’exclut pas que le genre masculin pourrait être soumis à une même analyse : parmi les machos aux gros muscles qui sauvent l’humanité, quelle place pour des modèles de masculinité différents, où les garçons seraient par exemple autorisés à pleurer ?
Une culture populaire soumise à des contradictions
Les productions médiatiques les plus populaires sont souvent d’origine américaine. S’il existe des centres de productions médiatiques importants en Inde (Bollywood) ou encore en Corée du Sud, ces œuvres restent largement inconnues chez nous et leur analyse serait plus hasardeuse dans la mesure où elles manifestent sans doute un système de valeurs plus complexe à maîtriser pour un regard européen. Dès lors, culture populaire rime souvent avec l’imaginaire anglo-saxon : univers de fantasy ou de sience-fiction, stars de la musique, grandes marques, séries télévisée ou jeux vidéo représentent des secteurs où les produits américains sont emblématiques. Cette domination américaine trouve ses origines dans l’histoire internationale et en particulier dans la place centrale qu’occupent les USA et leur économie depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette domination est souvent associée à la diffusion d’un système de valeur libéral et capitaliste où l’individualisme, l’argent et le consumérisme trônent.
Cependant, les critiques sévères, voire méprisantes, à l’encontre de la culture américaine masquent parfois les atouts qu’elle offre du fait de sa grande popularité en matière notamment d’analyse des représentations sociales plus « banales » comme, précisément, celles relatives aux genres. Car si cette culture est populaire, c’est tout de même qu’elle plait et qu’elle fédère le plus grand nombre, au-delà même des distances sociales. Qu’on soit ouvrier ou cadre d’entreprise, adolescent ou cinquantenaire, nous sommes susceptibles d’apprécier Games of Thrones et de nous précipiter dans les salles de cinéma pour découvrir la nouvelle déclinaison de l’univers de Star Wars. Même dominante, la culture américaine reste une marchandise qui craint la concurrence et dépend de sa rentabilité et donc du marché. La culture populaire ne constitue pas un déversement à sens unique de l’idéologie de l’Oncle Sam mais s’adapte aux évolutions sociales pour surtout, ne pas les contrarier.

Les déboires récents de l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna illustre bien ce fonctionnement mercantile. Ayant pour finalité une rentabilité qui dépend de ses revenus publicitaires, elle a subi de fortes pertes après que plusieurs marques aient annoncé ne plus vouloir être associées aux propos homophobes de l’animateur, alors que ces mêmes marques misaient jusqu’alors sur la popularité du personnage, en dépit de ses outrances répétées. Cet épisode télévisuel illustre que les sensibilités évoluent et que le marché culturel épouse cette évolution, quitte à contribuer à rendre obsolète les canons humoristiques qui firent jadis son beurre.
Éducation aux médias, genre et culture populaire
Il serait rapide d’accuser les médias de tous les maux comme c’est parfois le réflexe encore dans certains milieux[11]. Il ne s’agit pas d’envisager la relation entre médias et public comme unilatérale, le second étant façonnés par les premier, mais plutôt comme une discussion où ils se nourrissent et s’influencent. La vigilance des mouvements féministes quant aux représentations de genre ont fait l’objet de moqueries mais la récurrence de leur analyses ont finalement porté les médias à prêter une attention accrue à cet enjeu. Certains jugeront incohérent un message dénonçant une oppression dans un contexte commercial qui tend à légitimer un système porteur d’inégalités. Pourtant, cela ne remet pas en cause son potentiel émancipateur. Prenons l’exemple du spot publicitaire #likeagirl de la marque Always, dans lequel plusieurs adolescentes et garçons rient de l’expression « courir comme une fille ». Pour eux, ce terme renvoie à une manière de courir ridicule – agitant les mains et touchant ses cheveux – tandis que les filles prépubères que l’on interroge ensuite froncent les sourcils et miment de sprinter avec détermination. Un titre indique ensuite que l’estime des jeunes filles pour elles-mêmes semblent chuter au moment de la puberté, il est important qu’elles aient confiance en elles parce qu’être une fille n’est pas quelque chose de honteux ou de risible. Le spot se conclut sur le logo de la marque, accompagnée de la phrase « rewrite the rules ». Réécrire les règles.
La culture populaire s’inscrit dans un contexte temporel particulier dont elle se nourrit tout autant qu’elle l’influence. Alors que les protestations du mouvement Black Lives Matter fait rage et débats aux Etats-Unis, les séries, films, disques qui y font référence se multiplient, et contribuent à la reconnaissance de ce mouvement sur le plan international et à inspirer d’autre mouvements antiracistes[12]. Ce qui peut sembler n’être que du divertissement mercantile et futile permet avec le recul critique de faire apparaître une mosaïque de citations qui représentent l’air du temps et arment parfois les mouvements de contestation On comprend dès lors que la culture populaire n’est pas là « juste pour rire », ni une machination oppressante : elle devient un champ de bataille où des intérêts industriels se marient, contre toute intuition, à des revendications sociales, portées par des artistes, et suscitent auprès des populations des phénomènes d’appropriation et de détournement qui peuvent soutenir des contre-discours et des mouvements très engagés.
L’analyse critique de la culture médiatique populaire conduit à réfléchir sur la culture tout court et à s’armer dans une perspective de changement social. Elle permet d’impliquer un large public en mobilisant et valorisant ses références « ordinaires » et facilite ainsi le dialogue et l’engagement critiques. Une démarche d’éducation aux médias adressée à cette culture ne peut pas se réduire à en dénoncer le sexisme mais doit mettre en lumière les représentations qu’elle véhicule pour souligner les tensions qui traversent notre culture sociale. Cette approche peut alors contribuer à créer des chocs entre les images que la société se fait d’elle-même et sa réalité pour électrifier les contradictions sociales qui l’animent et au moins contribuer à les éclairer.
Média Animation
Rédaction :
Daniel Bonvoisin et Elisabeth Meur-Poniris
Références
Anon. Bechdel Test Movie List. http://bechdeltest.com/
John Berger, Ways of Seeing, Penguin Classics, 2008,
Mona Cholet, Chez soi, une odyssée de l’espace domestique, Zones, La Découverte, Paris, 2015, disponible en ligne : http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=197
Andy Zeisler, Feminism and Pop Culture: Seal Studies, Seal Press, 2008
MÈMETEAU, Richard, Pop Culture, Réflexion sur les industries du rêve et l’invention des identités, Zones, La Découverte, Paris, 2014, Disponible en ligne : http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=190
[1] “Men act and women appear. Men look at women. Women watch themselves being looked at. This determines not only most relations between men and women but also the relation of women to themselves. The surveyor of women in herself is male: the surveyed female. Thus she turns herself into an object-and most particularly an object of vision: a sight.”
[2] Le test de Bechdel sert à identifier si une fiction offre aux femmes une fonction narrative indépendante du genre masculin. Pour répondre à cette question, rien de plus simple, il suffit de répondre par l’affirmative à ces trois questions : l’œuvre a-t-elle deux femmes identifiables (qui portent un nom) ?; Parlent-elles ensemble ?; Parlent-elles d’autre chose que d’un personnage masculin ? C’est le cas de seulement 57,4% des 7261 films analysés. A noter cependant que l’épreuve donne chaque année de meilleurs résultats.
[3] BENJAMIN, Walter, « L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée », Zeitschrift für Sozialforschung, vol. 5, n°1, 1936, pp 40-68.
[4] YOBrussels Hip-Hop Generations, http://www.bozar.be/fr/activities/128044-yo
[5] Aez You Series ? International TV Series Festival, www.bozar.be/fr/activities/128580-are-you-series
[6] Certains livres peuvent évidemment devenir des produits de culture populaire, par exemple 50 shades of grey. Que l’on aime ou non, tout le monde en a entendu parler. Si je n’apprécie pas forcément les ouvrages mais je vis dans une société où un nombre considérable de personnes semble les avoir apprécié, ce qui a suscité une conversation à laquelle j’ai été confrontée.
[7] MÈMETEAU, Richard, Pop Culture, Réflexion sur les industries du rêve et l’invention des identités, Zones, La Découverte, Paris, 2014, 254 p. Disponible en ligne : http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=190
[8] Le sexe biologique d’une personne et son identité de genre ne vont pas toujours de pair : une personne née avec un appareil génital masculin peut s’identifier comme “femme”, estimant que la définition contemporaine de ce genre traduit davantage sa personnalité.
[9] La place souvent oubliée des femmes dans l’univers des informaticiens et mathématiciens, notamment deà la NASA, est Polémique Google, film les figures de l’ombre.
[10] Mona Cholet, Chez soi, une odyssée de l’espace domestique, Zones, La Découverte, Paris, 2015, disponible en ligne : http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=197
[11] Bien que certaines études montrent cette influence. Au Fiji, on a noté une hausse des désordres alimentaires chez les femmes dans la période qui a suivi l’introduction de la télévision en 1995. Au programme, une seule chaîne, diffusant des programmes tels que Seinfeld, Melrose Place, E.R., Xena, la guerrière et Beverly Hills 90210. Dans une société où les rondeurs étaient traditionnellement un signe de beauté du genre féminin, les régimes sont rapidement devenus une préoccupation courante et les résultats d’une recherche ont démontré que les filles qui déclaraient regarder la télévision au moins trois soirs par semaine avaient 50% de chances en plus de se décrire elle-même comme “trop grosses”. Goode, E. (1999). Study Finds TV Alters Fiji Girls’ View of Body. The New-York Times. http://nyti.ms/1kIrjHt
[12] Rien que dans les séries et films américains à succès sortis entre 2016 et 2017, citons les séries Atlanta (FX) et Dear White People (Netflix) ou le film Get Out de Jordan Peele.